Notules dominicales de culture domestique n°289 - 7 janvier 2007
DIMANCHE.
Internet. L'expédition des notules
se passe sans grosses difficultés. Bien sûr la photo ne passe pas
mais je m'y attendais un peu. Les notules étaient rarement illustrées,
elles sont en passe de ne plus l'être du tout. Un peu d'austérité
ne nuit pas dans ce monde voué à l'image, même si elle empêchera
peut-être l'illustration prévue en couverture de ce numéro,
la photo, sur le modèle de je ne sais plus quel magazine américain,
de "l'homme de l'année" :
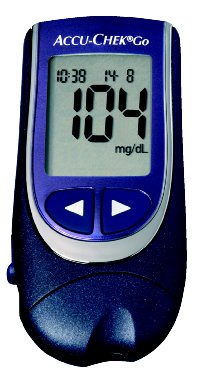
Lecteur
de glycémie
Vie
pantouflarde.
Ce soir, nous recevons pour le Nouvel An. J'aime à recevoir pour cette
occasion parce que je peux rester en chaussons. Je mets une belle limace, comme
ça personne ne me reluque les ribouis et je passe une bonne soirée,
les nougats en éventail. Remarquez, il m'est déjà arrivé
d'aller fêter le Nouvel An à l'extérieur en emportant mes
chaussons mais comme ça interloque toujours un peu, je préfère
tout de même faire ça at home.
LUNDI.
Bilan annuel 2006.
* 84 livres lus (+
4 par rapport à 2005)
* 139 films vus (- 23) dont 16 (- 20) au cinéma
* 90 pages de lecture de longue haleine (Sartre, Flaubert, Kafka, Proust, Blavier)
(+ 30)
* 190 abonnés aux notules version électronique (sans
oublier les irréductibles abonnés papier de l'Aveyron) (+ 33)
* 18.357 visites sur le site des notules (+ 5.519)
En ce qui concerne
mes chantiers littéraires :
* Inventaire 1998 toujours
en cours d'élaboration
* Aperçu de littérature passive
2001-2002 toujours pas mis au propre
* 70 éléments (+ 2)
pour l'inventaire Félicités
* 1.368 peintres étudiés
dans les Propos sur l'art peint (+ 64)
* 2.965 Souvenirs quotidiens
notés (+ 365, le compte est bon)
* 78 Nouvelles en deux lignes
(+ 1).
* 239 volumes étudiés dans L'Atlas de la Série
Noire (+ 32)
* 68 communes visitées (+ 12) de Ableuvenettes (Les)
à Boulaincourt dans le cadre de L'Itinéraire patriotique départemental
* 82 photos de Bars clos commentées (+ 7)
* 317 entrées
dans la Petite géographie de l'incipit (+ 49)
* 401 Bribes
oniriques recueillies (+ 57)
* 477 tableaux commentés dans la Mémoire
louvrière (+ 127)
* 131 publicités murales peintes photographiées
(+ 30)
* 173 numéros de téléphone récoltés
dans des films en vue d'un travail à venir (+ 33)
* 99 photographies
de salons de coiffure pour l'Invent'Hair (+ 49)
* 39 frontons d'école
photographiés dans l'Aperçu d'épigraphie républicaine
(+11)
* 21 Lieux où j'ai dormi retrouvés et photographiés
(+ 5)
* 34 numéros de Diasporama envoyés à 35
abonnés.
Parutions :
* Bulletin de l'Association Georges
Perec n° 49
* Bulletin de l'Association Georges Perec n° 50
*
Articles dans la page "Livres en liberté" de La Liberté
de l'Est.
* Notes de lecture et Chroniques de l'actualité littéraire
dans la revue Histoires littéraires n° 24-25-26-27.
Internet. Arrivée de certaines
notules littéraires sur le site lecture-ecriture.
TV. Les Compagnons de la marguerite
(Jean-Pierre Mocky, France, 1966 avec Claude Rich, Francis Blanche, Michel Serrault;
diffusé en décembre dernier sur CinéCinéma Classic).
Un expert en écriture, faussaire de génie, se lance dans la falsification
de documents d'état civil pour rendre leur liberté à des
conjoints malheureux en ménage.
Comme il le fera quelques années
plus tard dans L'Etalon, Mocky égratigne ici avec une jubilation
mal contenue le pacte conjugal. Le schéma est le même avec l'irruption
d'un personnage atypique dont les opinions anarchisantes viennent faire vaciller
les fondements de la société morale et auquel les autorités
se doivent de donner la chasse. D'où une succession d'embuscades, de poursuites,
de traquenards qui sont autant d'occasion de ridiculiser les autorités.
Un Mocky de bon aloi, qui permet, entre autres plaisirs, de voir Francis Blanche
habillé d'une robe de mariée.
MARDI.
Internet.
Je passe la soirée sur ma nouvelle machine, dotée de tous les attributs
du confort moderne, portable, wifi connectée au grille-pain de la pharmacie
et tutti quanti. Dire que dans deux ou trois ans, tout cela sera frappé
d'obsolescence... Mon ancienne adresse semble fonctionner, j'arrive même
à importer mon carnet d'adresses qui arrive en piteux état mais
que je parviens à peu près à mettre à jour. La vitesse
de réaction de l'engin est impressionnante et change de la vieille chaudière
qui mettait un bon quart d'heure à enregistrer un clic. Je peux désormais
écouter la radio en ligne, les émissions en différé,
ce qui met fin au ballet des programmations et des cassettes qui meublait mes
jours et mes nuits. Viendra ensuite l'apprentissage de l'archivage qui me promet
sans doute de beaux jours.
MERCREDI.
Courrier.
J'envoie une demande de résiliation à Orange, un contrat de location
pour les prochaines vacances d'été (la Haute-Vienne, trop peuplée,
est abandonnée, retour en Creuse), une brassée de voeux et des coupures
à Y.
Voyage. Je décarre
pour Paris par le 19 heures 32.
JEUDI.
Vie
parisienne. Le matin au Louvre (aile Richelieu, deuxième
étage, salle 24, Van Dyck), l'après-midi à la Bilipo (Série
Noire N° 373, 375, 380), ce n'est pas parce qu'on a changé d'année
que je vais changer de méthode de travail. J'ajoute cependant à
la journée deux escapades, l'une au Musée d'Art et d'Histoire du
Judaïsme, l'autre à la Maison de la Radio. Au musée, pour une
exposition, à la radio pour un enregistrement. J'ai déjà
fréquenté des lieux protégés ou dangereux, le Parlement
de Strasbourg, le Parc des Princes, mais jamais je n'ai subi pareille fouille
que pour entrer au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. J'y suis
pour une exposition consacrée à Gustave Kahn (1859-1936), un homme
présenté ici comme un symboliste qui eut son importance dans le
monde artistique au tournant du siècle. Juif lorrain (on trouve encore
quelques traces de lui à Metz), il fut l'ami et le protecteur de Jules
Laforgue, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, et eut son rôle,
comme ce même Laforgue, dans l'apparition du vers libre : s'il ne l'a pas
inventé (il n'y aura jamais d'accord sur la paternité de cette nouveauté),
il fut en tout cas le premier à le théoriser. Kahn publia de la
poésie (ses "Bonnes dames" données ici à lire et
à entendre valent le détour), dirigea des revues (La Vogue
où il fit paraître les Illuminations d'un sieur Rimbaud, négociant
en Afrique, La Revue indépendante), s'illustra dans la critique
d'art (où il fit preuve de la même clairvoyance que Roger Marx, il
serait étonnant que ces deux hommes ne se soient pas croisés un
jour), s'engagea dans plusieurs mouvements juifs et sionistes après l'Affaire
Dreyfus, ce qui lui vaut d'être montré ici. L'exposition a trois
qualités majeures : elle est gratuite, déserte et riche sans être
indigeste. Parmi les objets exposés, je m'attarde devant un numéro
de La Revue indépendante où je retrouve Léon Hennique
et un tableau, un Port de Collioure dû à un certain Jean Peské
qui est une petite merveille.
A la radio, j'ai eu envie d'assister à
l'enregistrement du Masque et la Plume, la seule émission pour laquelle
il m'arrive encore d'écouter France Inter. Le Masque, c'est une survivance,
comme Inter danse ou Le Jeu des mille francs, un maillon qui permet de s'arrimer
à la chaîne des générations. Prendre part à
l'enregistrement, c'est pour moi une manière de satisfaire ma curiosité,
même ma passion pour le monde de la radio, un univers qui m'a toujours fasciné
contrairement à la télévision dont les secrets de fabrication
ne m'intéressent pas. Jérôme Garcin enregistre deux émissions
à la suite, l'une consacrée aux livres, l'autre au cinéma.
A la tribune des livres, Jean-Louis Ezine cabotine gentiment comme à sa
habitude et on voit que son numéro avec Michel Crépu est bien rodé.
L'émission cinéma est moins enlevée, souffre de la défection
d'un des participants mais là aussi on voit bien que l'opposition entre
Bernard Murat et le jeune critique dont j'ai oublié le nom n'est que de
façade et cache une complicité bien au point. Tout cela est agréable,
un brin suranné (ça n'intéresse plus que les ploucs dans
mon genre ou celui des H. venus eux aussi de leur orientale province et rencontrés
fortuitement à l'entrée) mais brillant, je prends plaisir à
entendre parler de livres que je ne lirai jamais et de films que je n'irai pas
voir. Et puis voir des gens manier la parole avec autant de facilité est
toujours pour moi un spectacle fascinant.
Lecture.
Les vestiges de North Beach (Chasing the Dragon, Domenic
Stansberry, 2004; Gallimard, coll. Série Noire pour la traduction française;
traduit de l'américain par Samuel Todd; 336 p., 20 €).
Dante
Mancuso a été chassé de la police de San Francisco à
la suite d'une sombre histoire. Il retourne dans cette ville bien des années
plus tard pour une mission que lui a confiée la mystérieuse Agence
pour laquelle il travaille désormais et aussi pour enterrer son père.
Le passé ne va pas tarder à ressurgir...
Le passé, c'est
la matière première de ce polar. A la manière d'un Scorsese
transporté sur la côte ouest, Stansberry se livre à un exercice
de nostalgie : comment les émigrés italiens se sont fait peu à
peu grignoter par les Chinois, comment Little Italy est devenue Chinatown, comment
une mafia a pris la place de l'autre, ces questions hantent son personnage à
la recherche d'un temps définitivement perdu. C'est par ces thèmes
que l'auteur parvient à se rendre parfois intéressant, c'est là-dessus
que le livre peut avoir une certaine valeur. L'histoire policière en effet
est tellement embrouillée qu'elle perd rapidement tout intérêt.
VENDREDI.
Vie parisienne (suite).
Pas de fioritures aujourd'hui, juste le travail, en chambre le matin (j'ai apporté
le portable, c'est à ça que ça sert), à midi au Louvre
et à la Bibliothèque l'après-midi. Le 19 heures 42 part et
arrive à l'heure, ce qui est assez rare pour être souligné.
SAMEDI.
Courriel. Deux demandes
d'abonnement aux notules. Les Pays-Bas sont désormais territoire notulien.
Football. FC Metz - Lille OSC 0 - 2.
L'expédition à Saint-Symphorien n'est pas couronnée de succès.
Si j'étais resté à Epinal, j'aurais assisté à
une autre défaite, celle du SAS devant Compiègne. Rude soirée
pour le sport lorrain...
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°290 - 14 janvier 2007
DIMANCHE.
Courriel. Deux demandes d'abonnement aux notules.
Manutention. Nous nous affairons à
vider une pièce en prévision de l'arrivée, demain, d'un peintre
qui doit refaire le plafond ruiné par les fuites. J'encartonne quelques
centaines de cassettes et les monte au grenier. Leur prochain voyage sera sans
doute pour la déchetterie.
TV.
24 heures chrono (24, série américaine de Robert Cochran
& Joel Surnow avec Kiefer Sutherland, Kim Raver, Mary Lynn Rajskub, Gregory
Itzin, Jean Smart; saison 5, épisodes 9 & 10, diffusés jeudi
dernier sur Canal +).
LUNDI.
TV
scolaire. L'Esquive (Abdellatif Kechiche, France, 2004 avec
Osman Elkharraz, Sara Forestier; DVD Aventi).
Panthéon
des lettres. Les notules entrent dans la Pléiade, du moins par
la bande : JMP, abonné de Bruxelles et de longue date, est mentionné
dans le tome 3 des Oeuvres de Queneau, page 1567. Curieusement, l'éditeur
ne précise pas qu'il est notulien.
TV.
Quasimodo d'El Paris (Patrick Timsit, France, 1998 avec Patrick
Timsit, Richard Berry, Vincent Elbaz, Mélanie Thierry; diffusé sur
Canal + en décembre dernier).
Ça y est j'arrête, j'abandonne,
je jette l'éponge. C'est en septembre 1999 que j'avais entrepris d'écrire
systématiquement sur les films que je voyais, à la télévision
comme au cinéma. L'exercice est en passe de devenir un pensum, je m'en
rends compte depuis quelques semaines, et ne m'intéresse plus. Il s'agissait
au début de voir si j'étais capable d'écrire sur des images,
de donner un éclairage un peu différent des critiques habituelles
mais ça tourne au ronron et je préfère y mettre fin avant
qu'on s'en plaigne. Les films vus seront toujours consignés dans les notules
mais sans commentaires, sauf éventuelles exceptions. Curieusement, cette
décision intervient le jour où je reçois des nouvelles de
Gilles G. qui a retrouvé ma trace sur la toile après bientôt
trente ans de séparation et qui s'est reconnu dans le portrait du numéro
240 des notules.
MARDI.
TV scolaire.
Les Frères Grimm (Brothers Grimm, E.-U., 2005 avec Matt Damon, Heath
Ledger, Monica Bellucci; support DVD).
Courrier.
Une lettre de la banque. Les intérêts de mon "Livret bleu"
s'élèvent à 0,70 € et portent la somme qu'il
abrite à 29,84 €. Dès demain, prendre le téléphone,
demander le directeur, s'annoncer comme le représentant de la Didions
Investment Corp. et lancer d'une voix assurée de trader sortant de
prendre la température de Wall Street : "Tout sur le 8 dans la 6e
à Vincennes !"
TV. Le
chaud lapin (Pascal Thomas, France, 1974 avec Bernard Menez, Claude Barrois,
Daniel Ceccaldi; diffusé ce mois sur CinéCinéma Auteur).
Lecture. Le diable au désert.
Ananké Hel ! (Marc Décimo) suivi de Rires et larmes dans
l'armée (Paul Tisseyre-Ananké), les presses du réel,
coll. L'écart absolu, 256 p., 18 €).
Marc Décimo délaisse
pour un temps ses sujets de prédilection, Jean-Pierre Brisset et Marcel
Duchamp, pour se pencher sur un autre phénomène, Paul Tisseyre,
un obscur mais pas un oublié puisqu'André Blavier lui a consacré
plusieurs pages de ses Fous littéraires. Paul Tisseyre n'a pas toujours
été un fou, littéraire ou pas. Né en 1873 à
Paris, fils d'un garde républicain, il s'engage chez les spahis et participe
à sa première campagne au Dahomey dans les années 1894-96.
Il en retire un antimilitarisme farouche qui l'incite à témoigner
et à se lancer dans l'écriture avec un premier roman, Sous-offs
d'Afrique. Ce qui ne l'empêche pas de rempiler et de prendre part aux
missions Foureau-Lamy puis Flamand en Algérie et à travers le Sahara,
expéditions qui se déroulent dans des conditions proprement dantesques
que Décimo restitue à partir des documents de l'époque. Rendu
à la vie civile en 1901, Tisseyre, qui s'appelle désormais Paul
Tisseyre-Ananké, multiplie les activités, persiste dans la voie
littéraire avec Tartarin de Toulouse, dirige un cabaret, lance un
journal, Les Coulisses, qui ne connaîtra qu'un numéro tout
à la gloire du chanteur pacifiste Montéhus. Il entre alors dans
sa période mystique, se dit marqué et inspiré par Hel, "la
déesse ou géante de la mort dans la mythologie scandinave",
publie Hel ! (Dieu), simple résumé pour y livrer ses visions.
Il a retrouvé dans Hel l'origine du langage ("En préhistoire,
les pères de la race Blanche Gaëlle-Celte portaient le nom de AL,
qui se transforma en EL ou HEL, selon les 'accents' des divers dialectes, etc.").
C'est alors que l'on comprend ce qui a suscité intérêt de
son biographe : là où Jean-Pierre Brisset faisait naître le
langage dans le cri de la grenouille, Tisseyre trouve son origine dans les cris
des bêtes préhistoriques :
"Les cris du bison et de l'aurochs
:
AG OG'... EG... Gaël.
ceux du mammouth :
AD AD AD... ADAM.
de
la chèvre :
AM AM' MA' ME'... L'hommesse.
du bélier :
AB
BAB BE... BA-AABEL, BABEL.
etc."
Colon au Sénégal en
1903, candidat aux législatives en 1910, fonctionnaire dans l'administration
des Postes, malade, ruiné, Tisseyre trouve encore le moyen de s'engager
en 1914, récolte une blessure, navigue d'hôpital en hôpital
pour "paludisme chronique, psychasthénie, héroïnomanie,
dysenterie, fièvres bilieuses hémoglobinuriques" et autres
joyeusetés, se consacre toujours à Hel et et meurt à Paris
en 1931. "Puis Paul Tisseyre-Ananké-Hel ! fut définitivement
oublié", conclut Marc Décimo. Il était temps de le redécouvrir
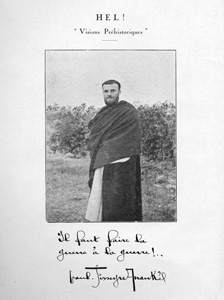
La
deuxième partie du volume reprend un ouvrage de Tisseyre publié
à l'origine en 1907 aux éditions Messein, Rires et larmes dans
l'armée. C'est un recueil de nouvelles écrites apparemment sur
le vif au cours des campagnes d'Afrique de l'auteur. Il y évoque le quotidien
du régiment de spahis dont il faisait partie : portraits de gradés
et de sans-grades, tranches de vie de cantonnement, relation d'escarmouches, anecdotes,
récits enchâssées à la Maupassant. On y trouve des
traces du Roman d'un spahi de Loti, des ressemblances avec le soldat Chapuzot
de Jean Drault, des échos d'Hector France, des images qui parlent ("Nous
manquions d'eau depuis vingt-quatre heures et l'oued était sec comme une
poitrine d''Anglaise") et partout, un souci d'humanisme, un effroi devant
les exactions commises au nom de la patrie, une véritable honte devant
les cruautés qui forment le quotidien de la troupe coloniale.
Extrait.
LE LEGIONNAIRE "SCHNICK"
Le légionnaire
Scrutoschimann de la 3e escouade, 1e section, 4e compagnie, 2° bataillon du
1er Régiment étranger est détaché à Aïn
Sefra.
C'est un vieux "birbe", un "dur à cuire"
qui a parcouru tous les blèdes, dans ses 19 ans de service. Il a 30 campagnes,
5 médailles dont "le médaillé militaire". Aussi
il rengage jusqu'à la gauche.
Scrutoschimann est un Alsacien qui a
quitté le pays du Kaiser pour ne pas servir la Prusse.
A vingt ans
il s'est présenté au colonel des hussards de Pont-à-Mousson
et après les formalités nécessaires a "piqué
une tête dans le Léchion".
En 19 ans, Scrutoschimann a bien
changé.
Ce n'est plus un jeune homme : c'est un brave soldat à
barbe déjà grise, tout ridé aux tempes et au front. Quoique
un peu francisé, son accent alsacien persiste toujours; mais c'est secondaire.
Scrutoschimann est connu sous le sobriquet de père "Schnick".
Le Schnick (alcool) est sa liqueur favorite. Le matin, son gosier de brisquard
est à sec et a des "Klairs" comme il dit : il faut "fusiller"
toute cette saleté-là !
Le père Schnick se cuite sept
fois par semaine.
Tous ses chefs le savent, mais ils n'en disent rien, car
Scrutoschimann est un poivrot pacifique.
Dans la cuite, ses yeux d'homme du
nord sont un peu plus bleus, sa langue tourne un peu plus mollement, mais son
service n'en souffre pas.
C'est un rude troupier que le père Schnick
! et d'une propreté !...
- Pas un homme du "Léchion"
qui peut s'aligner avec lui !
Scrutoschimann a des bourgerons blancs comme
une cornette de religieuse; ses pantalons sont pincés comme ceux d'un gentleman.
A n'importe quelle heure du jour ou de la nuit on peut "chauffer" le
père Schnick pour une revue de détail.
"Mein Gott ! on
ne le surprendra pas; on aura une revue remarquable.
Tous les boutons des
effets sont cousus au fil poissé; dans la trousse, il y a des pièces
préparées à l'avance pour les réparations; il y a
des petites curettes, des petits clous recourbés, un tas de petites choses
qui servent aux grands astiquages.
En ce moment, le père Schnick est
assis devant sa tente. La Compagnie devant camper quelques jours par suite d'un
changement de garnison, la manoeuvre est "suspendue". Schnick profite
de ce repos pour examiner son "bazar".
Il a graissé ses godillots,
astiqué son fusil, "contrôlé" ses boutons de guêtres,
replié son linge pour la dixième fois et manifesté son contentement
en envoyant des crachats répétés dans ses grosses mains calleuses.
Soudain le père Schnick prend une nouvelle décision.
S'il finissait
la ceinture ?... Oui, la ceinture ! vous semblez ne pas comprendre. Mais la ceinture,
dans la "Léchion" c'est la moitié de l'existence ! fantassins
de l'Est, dragons, zouaves, pompiers ! vous n'entendez rien à la confection
d'une bonne et confortable ceinture de légionnaire.
Renseignez-vous
auprès du père Schnick et vous verrez... lui seul s'y connaît,
Barka !...
La ceinture Schnick est un poème. La ceinture Schnick pèse
exactement 627 grammes. Elle est confectionnée avec du drap de capote.
Le drap de pantalon est moins estimé, car les broderies y ont moins de
reflets.
Ces broderies sont distinctes selon l'arme et le régiment
: canons en batterie pour les artilleurs; croissants pour les Tirailleurs; Etoiles
pour les spahis. Et pour les légionnaires un grand cancrelat autrement
dit un "cafard" tel qu'il figure sur les armes symboliques du blède
de Géryville.
La ceinture Schnick a 35 poches de dimensions différentes
:
Première poche : une poignée de riz.
Deuxième poche
: vingt-cinq boutons.
Troisième poche : un peu de sublimé.
Quatrième : un crayon.
Cinquième : une petite scie.
Sixième
: un morceau de bougie.
Septième : du nitrate d'argent.
Huitième
: un briquet.
Neuvième : rubans pour médailles.
Dixième
: blanc de guêtres, cire noire.
Treizième : (chut !) un peu de
dynamite...
Arrêtons-nous là.
Vous ne croyez pas, vous, qu'il
soit absolument nécessaire d'avoir tant de choses dans une ceinture ? et
vous trouvez cela un tantinet ridicule ?
Allez le dire au père Schnick
!
Ridicule, la grande ceinture Schnick pour les "grandes" campagnes
?
Tous les jurons du "Léchion" vont y passer.
- Godfordom
! En 1882, Sturgmann enfermé trois jours dans un bastion, au Tonkin, ne
mourut pas de faim grâce à une poignée de riz !
- Sacramento
! Picationi fut nommé 1re classe, au retour de Tunisie, grâce à
la blancheur permanente de ses guêtres !
Christo la Madona ! un copain
du père Schnick fut guéri d'un "coup de pied" de Vénus
dahoméenne par des lavages au sublimé. Grüfertz, fait prisonnier
au Panaï par les Pavillons Noirs, coupa les barreaux de sa prison avec une
scie minuscule et échappa à la torture que les pirates lui réservaient.
Et si l'on est en sentinelle avancée, près d'un grand pont, par
exemple; que 3.000 ennemis avancent, au pas de charge, pour surprendre la colonne
?... Avec un peu de dynamite, le pont saute, l'ennemi est englouti... la colonne
est sauvée et en cinq secs le tour est joué ! !
Et les clous,
le fil, le briquet ! Mein Gott ! le meilleur soldat du monde est un sale troupier
sans la ceinture du père Schnick !
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Mais le rassemblement sonne. Les officiers suivent le colonel à la salle
du rapport.
Le vieux légionnaire dresse l'oreille... Qu'y a-t-il ?
On demande des volontaires pour Madagascar !...
Il court se présenter,
le père Schnick. Qu'est-ce que ça peut lui foutre de partir ? Sa
ceinture est prête.
Djennien bou Rezg, 1898
MERCREDI.
Emplettes. J'achète la correspondance
d'Héloïse et Abélard et un volume de Daudet, relis de suite
"La dernière classe", la première histoire des Contes
du lundi. Je m'étonne toujours de constater combien, chose peu connue
à mon sujet, certaines images, certaines histoires, certaines chansons
parfaitement idiotes ou peut-être pas si idiotes que ça peuvent m'émouvoir
et m'ébranler durablement.
TV. Le
petit lieutenant (Xavier Beauvois, France, 2005 avec Jalil Lespert, Nathalie
Baye, Roschdy Zem, Antoine Chappey; diffusé ce mois sur Canal +).
Les
jeunes enfants de Roschdy Zem ont été invités à jouer
dans le film. Aucun des deux ne se prénomme Jean-Phi.
JEUDI.
TV. 24 heures chrono (24, série
américaine de Robert Cochran & Joel Surnow avec Kiefer Sutherland,
Kim Raver, Mary Lynn Rajskub, Gregory Itzin, Jean Smart; saison 5, épisodes
11 & 12, diffusés ce jour sur Canal +).
On admirera l'habileté
des terroristes qui parviennent toujours à programmer le retardateur de
leur bombe de façon à ce que la fin du compte-à-rebours coïncide
à la seconde près avec celle de l'épisode.
VENDREDI.
Obituaire. J'apprends avec tristesse et retard
la mort de Pierre Louki, un des derniers survivants de la galaxie Brassens et
dont j'aimais la voix toujours à la limite de la justesse.
"Quand
on m'aura couché sous terre
Dans combien de temps je ne sais
Quand
les copains seront passés
En me disant salut vieux Pierre..."
TV. Ballade pour un voyou (Jean-Claude
Bonnardot, France, 1962 avec Laurent Terzieff, Hildegarde Knef, Philippe Noiret,
Daniel Emilfork, Michel Vitold; diffusé ce mois sur CinéCinéma
Classic).
SAMEDI.
TV scolaire.
Elephant (Gus Van Sant, E.-U., 2003 avec Alex Frost; Eric Deulen; John
Robinson; support DVD).
Football. S.A.
Epinal - Mulhouse 1 - 0. Ce n'est pas une victoire qu'on encadrera dans la salle
à manger mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas quitté
la Colombière le coeur léger.
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°291 - 21 janvier 2007
DIMANCHE.
Aménagement du territoire. Remise des
meubles en place après le passage du peintre et avant la prochaine inondation.
Nous passons aussi un moment à ranger ce qui a été acheté
en soldes. D'habitude, je ne me mêle pas des acquisitions de Caroline qui
est assez grande pour remiser ses effets toute seule mais comme elle a cette fois
acquis une machine à laver il faut bien que je m'y attelle.
TV.
Football. Stade Rennais - Olympique de Marseille 0 - 2, en direct sur Canal +.
Pas de commentaire, par charité envers R, notulien rennais.
LUNDI.
TV. Gentille (Sophie Fillières,
France, 2005 avec Emmanuelle Devos, Lambert Wilson, Bruno Todeschini, Michael
Lonsdale, Bulle Ogier; diffusé ce mois sur Canal +).
MARDI.
Courrier. Je reçois, précieuses
étrennes, l'enregistrement des lettres d'Emmanuel Chabrier lues par Claude
Piéplu, récemment diffusées sur France Musique.
TV. Tiré à part (Bernard
Rapp, France, 1996 avec Terence Stamp, Daniel Mesguich, Maria de Medeiros, Jean-Claude
Dreyfus; diffusé ce mois sur CinéCinéma Frisson).
MERCREDI.
Courriel. Echange avec
Roger L. avec qui j'ai travaillé une année, 1982-1983, dans un collège
de Bar-le-Duc et retrouvé au hasard des connexions notuliennes. Bien sûr,
il ne se souvenait pas de moi, ce qui n'est guère surprenant. A cette époque,
non content de cultiver déjà la transparence, j'étais de
plus totalement insignifiant. Je débutais dans le métier, j'observais,
j'étais entouré de gens plus âgés que moi qui me semblaient
diablement sérieux alors qu'ils l'étaient en fait beaucoup moins
que les jeunes collègues que je vois débarquer aujourd'hui. En ce
temps-là je n'étais pas loin de mon adolescence, j'étais
frais émoulu de mes années d'initiation professionnelle qui avaient
eu pour cadre le centre de formation des PEGC de Nancy. Un PEGC, la race est quasiment
éteinte, c'était un professeur d'enseignement général
de collège, destiné à enseigner deux matières, l'anglais
et le français pour moi. Je ne savais pas alors que les PEGC étaient
considérés comme la lie de la profession - certains membres du corps
inspectorial allaient se charger de me le faire savoir un peu plus tard -, que,
par exemple, dans certains collèges (mais pas ceux que j'ai fréquentés),
les agrégés et certifiés ne mangeaient pas à la même
table qu'eux à la cantine, voire ne partageaient pas la même salle
des professeurs. L'eussé-je su que ça ne m'aurait pas violemment
affecté, j'avais un boulot, je le faisais, un point c'est tout, l'orgueil
professionnel ne me chatouillait déjà pas beaucoup. Le centre de
formation des PEGC de Nancy était un drôle d'endroit peuplé
de drôles de gens. Construit pour abriter d'importantes cohortes de stagiaires,
il n'en accueillait déjà plus qu'une poignée au moment de
mon arrivée. Seuls quelques box étaient occupés dans l'immense
internat façon Saint-Agil, le bizutage manquait de conviction, les couloirs
et les salles de l'immense bâtiment sonnaient le creux. Le public était
disparate, composé de quelques jeunes qui, comme moi, avaient réussi
le concours d'entrée à l'Ecole Normale à quatorze ou quinze
ans et qui s'étaient dit qu'il était préférable de
devenir professeur qu'instituteur (il n'y avait pour franchir le pas qu'un semblant
de concours à passer), d'étudiants chevronnés et brillants
qui trouvaient là un environnement douillet et rémunéré
dans lequel ils pouvaient préparer des concours plus prestigieux, et des
instituteurs qui avaient décidé de changer de branche, des adultes,
des vrais avec famille et permis de conduire, qui m'impressionnaient fortement
: H., devenu entre-temps ambassadeur plénipotentiaire de la notulie en
terre canadienne, H. donc avait vingt-six ans, il m'apparaissait comme un vieux
sage. L'enseignement de l'anglais était fait de façon sérieuse,
rigoureuse, par des gens compétents, souvent remarquables. Pour le français,
c'était une autre musique. On trouvait là des formateurs pour qui
la nomination en ces lieux n'avait pas dû être une promotion, des
ratés des classes préparatoires et des placardisés qui formaient
une pétaudière pédagogique plus effrayante qu'amusante, une
sorte de magistrale armée de Bourbaki avec ses matamores, ses gueules cassées
et ses tire-au-flanc. Dans la galerie, L., professeur de psychologie, homme bonasse
échappé d'une nouvelle d'Erckmann-Chatrian, P. dont la trogne couperosée
expliquait aisément les deux heures de retard qu'il s'accordait chaque
matin avant de pointer, P., un autre, qui grillait consciencieusement ses dix
Gauloises à l'heure en parlant de linguistique ou de Beaumarchais, T. qui
masquait le côté bâclé de son travail sous une démagogie
puante ("allez, aujourd'hui il fait beau, on va au bistrot plutôt qu'en
cours") dans laquelle je refusais d'entrer. T. ne m'aimait pas, inutile de
le dire. Je revois aussi B., un ragondin, un sinistre, un nuisible. B. non plus
ne m'aimait pas, mais je n'ai jamais su pourquoi. Peut-être souhaitait-il
des élèves brillants, les élèves des grandes écoles
où il n'avait pu officier, je n'étais pas brillant, j'étais
un tâcheron insoucieux de tous les équipages, j'apprenais. Et puis
un autre B., que j'allais oublier, un professeur de traduction qui écrivait
des pièces de théâtre et nous en offrait, pour étrennes,
des exemplaires sauvés du pilon. Je ne sais toujours pas si ces gens pensaient
avoir de l'importance, certains en tout cas semblaient en être persuadés.
Tout ce que je sais, c'est que je ne leur dois pas grand-chose, sinon une méfiance
durable qui m'a sagement tenu à l'écart de toute compromission avec
les hiérarques de ce milieu et une prudence qui m'a toujours empêché
de me prendre au sérieux par crainte de leur ressembler un jour. Mais j'ai
gagné là, du côté de mes condisciples, quelques solides
amitiés qui durent toujours.
TV.
Le temps qui reste (François Ozon, France, 2005 avec Melvil Poupaud,
Jeanne Moreau, Valeria Bruni Tedeschi, Daniel Duval, Marie Rivière; diffusé
ce mois sur Canal +).
JEUDI.
Courrier.
Je ventile quelques Bulletins Perec (un exemplaire à Françoise Treussard,
des Papous de France Culture, pour l'hommage à Bertrand Jérôme),
envoie des coupures à Y. et des photos à J. Sur le plan réception,
arrivée d'un disque des musiques composées par Michel Magne pour
les films de Jean Yanne, acheté pour le moment d'éternité
que constitue le "Jésus tango" de Ginette Garcin : "Dans
les bras de Jésuuuuuuus..."
TV.
24 heures chrono (24, série américaine de Robert Cochran
& Joel Surnow avec Kiefer Sutherland, Kim Raver, Mary Lynn Rajskub, Gregory
Itzin, Jean Smart; saison 5, épisodes 13 & 14, diffusés ce jour
sur Canal +).
VENDREDI.
Aptonymie
de proximité. On fait, je fais parfois des kilomètres
à la recherche d'hypothétiques aptonymes sans voir ou entendre ceux
qui miaulent et bêlent à nos portes. Ainsi, ce n'est que ce matin
que je découvre ce vétérinaire spinalien :

SAMEDI.
TV. Sur la route de Madison (The
Bridges of Madison County, Clint Eastwood, E.-U., 1995 avec Clint Eastwood,
Meryl Streep; diffusé ce mois sur CinéCinéma Emotion).
Lecture. Dans les bois éternels
(Fred Vargas, Viviane Hamy , 2005, coll. Chemins nocturnes; 448 p., 18 €).
Le commissaire Adamsberg est confronté à une succession de meurtres,
de profanations de sépulture et de massacres de cervidés. Reste
à trouver le lien qui unit ces trois séries d'événements
macabres.
Fred Vargas continue avec un succès éditorial grandissant
son parcours dans le domaine du polar, un parcours qui va à rebours des
lois du genre. Là où l'on voit habituellement le roman policier
comme un miroir des moeurs d'une époque, une sorte de révélateur
social souvent pertinent et efficace, elle se détourne sciemment de la
réalité contemporaine pour lancer son commissaire fétiche
dans des histoires intemporelles qui remettent à l'honneur des peurs ancestrales,
des coutumes oubliées, des fantasmes de toute éternité (ici,
une recette pour conquérir l'immortalité). La géographie
de Fred Vargas est aussi mythique que ses histoires. Sous les vents de Neptune,
son roman précédent, avait pour cadre un Québec de carte
postale plein de clichés et d'idiotismes, la Normandie qui abrite ici une
partie de l'intrigue est tout aussi déréalisée, le Paris
que traverse Adamsberg n'existe que par rapport au personnage. Le même traitement
affecte les personnages qui constituent une brigade policière pleine de
doux rêveurs et d'improbables frelampiers rappelant le monde attachant du
Pennac des débuts. Ces choix séduisent et donnent à ses romans
une touche originale qui explique une partie de son succès. L'autre partie
est due à la qualité des intrigues, au mélange d'intuition
bohème et de rigueur avec lequel les enquêtes sont menées.
On ne sait si ça durera aussi longtemps que les contributions (il y a tout
de même des moments d'essoufflement, des baisses d'intérêt
au milieu du livre) mais pour l'instant, ça marche.
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°292 - 28 janvier 2007
DIMANCHE.
Poussière. Nous poussons jusqu'à
Remiremont où se tient une foire aux livres d'un genre un peu particulier
dans la mesure où les ouvrages proposés ne sont pas en vente mais
offerts. On peut verser un écot dans une urne si l'on veut, c'est tout.
J'en rapporterai quatre Série Noire cartonnés mais pas le Maigrir
et rester mince de Demis Roussos que je regrette déjà.
LUNDI.
Obituaire. "Je me souviens
de l'Abbé Pierre" (Georges Perec, Je me souviens, Jms n° 370).
TV. Le Maître du jeu (Runaway
Jury, Gary Fleder, E.-U., 2003 avec John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman,
Rachel Weisz; diffusé ce mois sur Canal +).
Vie
moderne. Je suis parfois effaré par les archaïsmes qui
parsèment mon existence. Si je devais dresser ici la liste de mes comportements
dépassés, je pourrais commencer ainsi : acheter et lire des journaux
en papier, utiliser des mouchoirs en tissu, porter des maillots de corps (pas
des tee-shirts, des vrais maillots de corps de La Redoute) sous mes chemises
en hiver et des caleçons longs sous mes jeans quand je vais au match, me
raser le dimanche, lire parfois des livres non coupés, acheter des CD -
encore cette semaine, le dernier Dylan, ça fait vingt-cinq ans que j'achète
le dernier Dylan, je l'écoute, je le range et j'attends le prochain, tout
ça pour essayer de retrouver le moment de sidération vécu
lors de la première écoute de Blood On The Tracks, "t'was
in another lifetime, one of toil and blood...", c'est le cas de le dire
- enregistrer et écouter des cassettes, persister à voter pour un
parti dont la gloire est bien ternie et qui ne fait plus peur à personne,
écrire des lettres, noircir des cahiers, fumer des cigarettes, goûter
en rentrant de l'école, regarder des films en noir et blanc, ce n'est qu'une
ébauche, il y a cent autres choses que je continue à faire et qui
décemment ne se font plus à notre époque. Et pourtant. En
l'espace de quelques jours, j'ai changé d'ordinateur, j'ai réussi
à enregistrer une émission de radio sur un CD et ce soir, je crée
une nouvelle adresse internet pour remplacer celle qui disparaîtra avec
mon ancien abonnement le 1er février. Décidément, le doute
n'est pas permis : je suis un homme du XXIe siècle.
MARDI.
Courriel. En plus la nouvelle adresse fonctionne.
Je reçois une demande d'abonnement aux notules.
MERCREDI.
TV. Le Procès Paradine (The
Paradine Case, Alfred Hitchcock, E.-U., 1947 avec Gregory Peck, Ann Todd,
Charles Laughton, Alida Valli; diffusé ce mois sur CinéCinéma
Classic).
Lecture. Les poules
(Dominique Resch, transbordeurs, 2006; 120 p., 13 €), lecture logique
à la suite d'un film d'Hitchcock.
C'était au début du
mois, boulevard Saint-Michel à Paris. Les éventaires devant chez
Gibert. A la montre, au rabais, pas mal de vieux rossignols mais aussi des livres
de moins d'un an, des titres remarqués au cours des dernières rentrées
littéraires, certains chroniqués ici même. On place ce qu'on
a de plus cher - qui, parfois, c'est vrai, ne vaut pas grand-chose - dans un bouquin
et on se retrouve trois mois plus tard dans les bacs à un euro... Pour
un premier roman, ce qu'on a de plus cher, c'est soi même, on déguise
souvent plus ou moins son autobiographie dans son premier roman et c'est une part
de soi, son enfance, ses amours, ses passions qui jaunissent sur le trottoir.
On souhaite un meilleur sort à ce premier texte de Dominique Resch qui
raconte ici son enfance à Bazegney, un village de la plaine vosgienne.
Dieu merci, on échappe aux poncifs de l'enfance rurale, les pots de confiture
dans le buffet, les draps qui sentent la lavande et les doigts tachés d'encre.
A Bazegney, ça sent la vache, la fiente de poule et l'eau de Javel, les
grands-mères ont de vraies rides et ne jouent pas les confidentes pour
prépubères. C'est une grand-mère qui est le personnage central
des Poules, une grand-mère cassée en deux, "un véritable
angle droit. Un vrai. En dur. De la physique. Du concret. De la matière
qu'on touche. Elle marchait comme ça, à quatre-vingt-dix degrés.
Dans cette position inhabituelle pour un humain. Quatre-vingt-dix degrés
pile. Six heures et quart sur la pendule." Une grand-mère à
la hauteur du narrateur qui, myope comme une taupe, vit dans un monde flou, incompréhensible.
Les pages d'ouverture, consacrées à cette vision décalée
du monde et les passages concernant la grand-mère, dont la mort constitue
l'épilogue, forment le meilleur du livre, avec un mélange d'humour
et d'émotion bien dosé. Entre-temps on aura trouvé un peu
plus faible le récit des premiers émois du jeune garçon qui,
bien longtemps après que Ricet Barrier eut chanté "La fille
du catalogue", collectionne les photos des beautés de La Redoute
et de Jours de France, avide de découvrir d'autres poules que celles
qui fientent. Un ensemble un peu inégal mais qui, par son absence de prétention
et une fraîcheur de ton bienvenue, parvient à emporter le morceau
et mérite un autre avenir que celui des bacs à soldes.
Dominique
Resch est notulien.

JEUDI.
TV. Je vous trouve très beau
(Isabelle Mergault, France, 2005 avec Michel Blanc, Medeea Marinescu, Wladimir
Yordanoff; diffusé ce mois sur Canal +).
VENDREDI.
Courrier. Arrivée du n° 27 de la
revue Histoires littéraires. Mes chroniques du n° 26 sont donc disponibles
ici : http://pdidion.free.fr/chroniques/chroniques_2006.htm
SAMEDI.
TV scolaire. Les
Misérables (Robert Hossein, France, 1982 avec Lino Ventura, Jean Carmet,
Michel Bouquet, Evelyne Bouix; DVD L.C.J. Légendes du cinéma français).
Presse. Dans La Liberté de
l'Est du jour, cette relation un brin complaisante d'un événement
local :
Trahi par sa cigarette
"X.,
proviseur du lycée Y, ne rigole pas avec le règlement intérieur.
Les mardis et jeudis étant déclarés "journées
non fumeurs", il se montre intransigeant s'il aperçoit un élève
"rebelle". C'était le cas jeudi. Depuis le bureau d'accueil de
l'établissement, il surprend un lycéen une cigarette à la
bouche. Elle n'était pas allumée mais la sanction est tombée
car tous les signes rappelant l'état de fumeur sont proscrits. "Tu
vas voir le CPE et c'est deux heures de colle", punit le proviseur. L'élève
tente une conciliation, avançant ne pas avoir vu ce passage du règlement
interdisant cette pratique. "Mais tu te prends pour qui ?" tient tête
X, et de stopper toute discussion en cassant la cigarette en deux. L'élève
n'a finalement pas eu le temps de se rendre à l'extérieur du lycée
où, là, la cigarette est tolérée. Quelques mètres
lui ont manqué; il aura tout le temps d'y penser lors de ses deux heures
de colle."
Voilà un homme comme je les aime, droit dans ses
bottes mais ouvert au dialogue, sachant user avec mesure de la parcelle d'autorité
qui lui est consentie. S'il n'est pas trop tard, je vais de ce pas demander à
être muté dans ce lycée. J'ai hâte de travailler sous
la férule de ce héros des temps modernes qui élève
un vulgaire mégot au rang du sabre du capitaine Dreyfus.
TV.
L'Incorrigible (Philippe de Broca, France, 1975 avec Jean-Paul Belmondo,
Julien Guiomar, Geneviève Bujold; diffusé ce mois sur CinéCinéma
Famiz).
Bon dimanche.